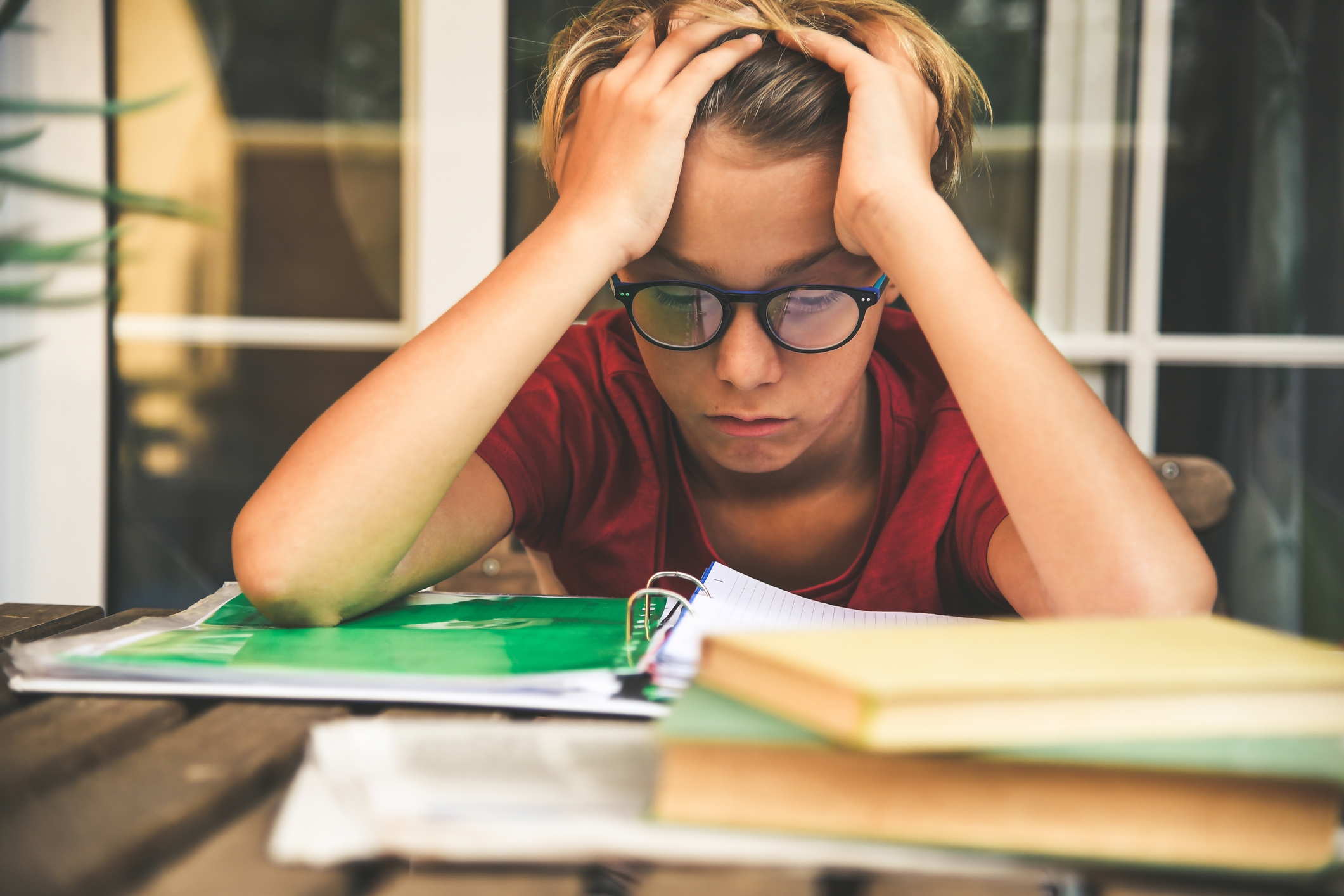Elle est suivie en orthophonie. Elle bénéficie d’aménagements pédagogiques adaptés mais elle a encore du mal à suivre à l’école parce qu’elle est lente. Au quotidien aussi, elle est lente et oublie souvent ce qu’elle doit faire. Ses parents ont du mal à comprendre pourquoi elle a toujours besoin de temps pour comprendre ou appliquer une consigne et perdent patience. Parfois, ils se demandent même si Marilou ne fait pas exprès d’être aussi lente et n’y mettrait pas un peu de mauvaise volonté. L’enseignante aussi se sent désemparée car Marilou alterne entre lenteur et même rythme que les autres.
Quelles sont les causes de la lenteur ?
Lorsqu’un enfant présente un trouble des apprentissages, la lenteur apparente dans les tâches scolaires ou quotidiennes n’est pas due à un manque de volonté ou à de la paresse. Elle reflète plutôt une surcharge du cerveau à faire plusieurs activités à la fois. Cela entraîne une fatigabilité et donc une lenteur. C’est une différence du traitement des informations par les neurones. Le cerveau reçoit trop d’informations et n’est plus capable de bien les gérer simultanément.
Un traitement de l’information ralenti
Les enfants qui présentent un trouble neurodéveloppemental des apprentissages comme un trouble spécifique du langage écrit (ou dyslexie), un trouble développemental du langage (ou dysphasie), un trouble développemental de la coordination (ou dyspraxie) ou un trouble spécifique de la cognition mathématique (ou dyscalculie) ont souvent un traitement de l’information ralenti. Il leur faut souvent plus de temps que leurs pairs pour réaliser certaines tâches. Par exemple, ils se montrent plus lents pour comprendre une consigne, orale ou écrite, mais aussi décoder les informations qu’on leur transmet. Lire, écouter une consigne, repérer des éléments importants dans un texte sont des activités qui leur demandent plus de temps que la moyenne. Ils ont aussi besoin de plus de temps pour planifier et organiser une tâche.
Les enfants qui présentent un trouble neurodéveloppemental sont aussi intelligents que les autres mais leurs circuits de neurones fonctionnent différemment. Ils doivent donc souvent fournir un effort supplémentaire pour accomplir une tâche que d’autres font automatiquement.
Une charge cognitive trop importante
Un enfant avec un trouble des apprentissages mobilise une plus grande quantité de
ressources mentales pour des tâches simples. Par exemple, un enfant dyslexique consacre tellement d’attention et de temps à déchiffrer les mots, qu’il ne lui en reste plus assez pour comprendre le sens global d’un texte. Il a alors besoin de le relire au moins une fois pour déchiffrer les mots un peu plus vite et commencer à comprendre ce qu’il lit.
Un enfant dyspraxique risque de passer plus de temps à organiser ses gestes pour écrire ou utiliser ses outils. Pendant qu’il exécute cette tâche, qui lui demande beaucoup d’efforts cognitifs, il n’est pas en capacité de se concentrer sur le travail à faire.
Un enfant dyscalculique va prendre du temps pour comprendre l’énoncé d’un problème puis se remémorer comment poser et résoudre une opération, en plus de décider quelle opération il doit effectuer pour résoudre le problème.
Une mémoire plus faible
Souvent, la mémoire de travail des enfants présentant un trouble du neurodéveloppement est moins efficace que chez les enfants n’ayant pas de trouble des apprentissages. Or, la mémoire de travail est constamment utilisée car elle permet de garder en mémoire pendant quelques instants une information, le temps de l’intégrer, la modifier puis la restituer.
Par exemple, quand l’enfant apprend à lire, il doit identifier une lettre et le son correspondant à cette lettre, le mettre en mémoire pour passer au son suivant puis mettre ensemble ces sons pour former une syllabe. Une fois la syllabe identifiée, elle doit à son tour être mise en mémoire pour passer à la syllabe suivante et les relier ensemble pour lire un mot. Pour effectuer une telle tâche, l’enfant utilise sa mémoire de travail. Si elle n’est pas assez efficace, il va devoir faire beaucoup d’efforts pour se souvenir de ce qu’il a lu. Parfois même, il devra recommencer ce qu’il a déjà fait pour l’intégrer et bien le mémoriser. Même si cela prend du temps, ce besoin de répétitions est essentiel car il va permettre d’automatiser les processus.
Conséquences de la lenteur
La lenteur n’est pas un défaut mais elle peut être gênante au quotidien, quand l’enfant ne parvient pas à suivre les apprentissages scolaires et qu’il termine toujours ses évaluations après les autres. Les conséquences émotionnelles sont donc possibles et peuvent encore plus le ralentir. En effet, en plus d’être lent, il peut avoir peur de se tromper ou de rater une information importante énoncée par l’enseignant. En cas d’échecs répétés, il peut développer un manque de confiance en lui et ne plus être motivé pour apprendre. Enfin, la lenteur peut engendrer du stress, ralentissant encore plus les capacités de traitement de l’enfant.
Comment aider un enfant lent ?
Les enfants présentant un trouble neurodéveloppemental sont souvent conscients de leurs difficultés et mettent eux-mêmes en place des stratégies de compensation. Plus ils sont âgés, plus ces stratégies sont efficaces et rapides mais, selon la tâche à réaliser, il faut appliquer la stratégie la plus adaptée au travail demandé. Pour cela, il est utile d’aider l’enfant dans la mise en place des stratégies. Cela passe par une explication claire et précise de la manière dont il pourrait s’y prendre puis par son utilisation répétée, pour la maîtriser. Une fois cet apprentissage effectué, il faut savoir que l’automatisation demande du temps, encore plus chez un enfant avec un trouble des apprentissages. Car il doit vérifier mentalement son raisonnement, se corriger en cours de route si besoin et, parfois, rechercher une autre solution plus adaptée. Ce processus s’appelle la métacognition. Cela consiste à se poser des questions sur la manière dont on apprend pour comprendre son propre fonctionnement d’apprentissage. La métacognition est indispensable à tout apprenant.
Pour aider un enfant qui est lent, des aménagements pédagogiques adaptés peuvent être proposés par l’école. Par exemple, il est possible de lui proposer des exercices assez courts, contenant une seule consigne à la fois. Une fois, celle-ci terminée, une pause permet à l’enfant de recharger ses batteries et de passer à l’exercice suivant dans de bonnes conditions. Il est aussi possible de proposer des exercices ciblés et répétitifs, ce qui est important pour permettre de renforcer les automatismes en adoptant toujours la même stratégie pour un même exercice.
Il est bénéfique de reprendre à la maison ce qui est entrepris à l’école, afin de favoriser l’automatisation des processus. Cela donne confiance à l’enfant qui, quel que soit son lieu d’apprentissage, reçoit des aides similaires.
Et bien sûr, tout au long de l’apprentissage, il est essentiel de valoriser les progrès, même petits.
Un enfant qui présente un trouble neurodéveloppemental est très souvent plus lent que ses pairs. Ce n’est ni un manque d’intelligence ni de la paresse ou du désintérêt mais le signe d’un fonctionnement cognitif différent, qui a besoin de plus de temps pour s’organiser et apprendre. Il est donc indispensable de respecter cette différence, en soutenant l’enfant dans ses apprentissages par la mise en place d’aides spécifiques, à l’école comme à la maison, mais aussi en veillant à l’encourager dans ses efforts et ses progrès.