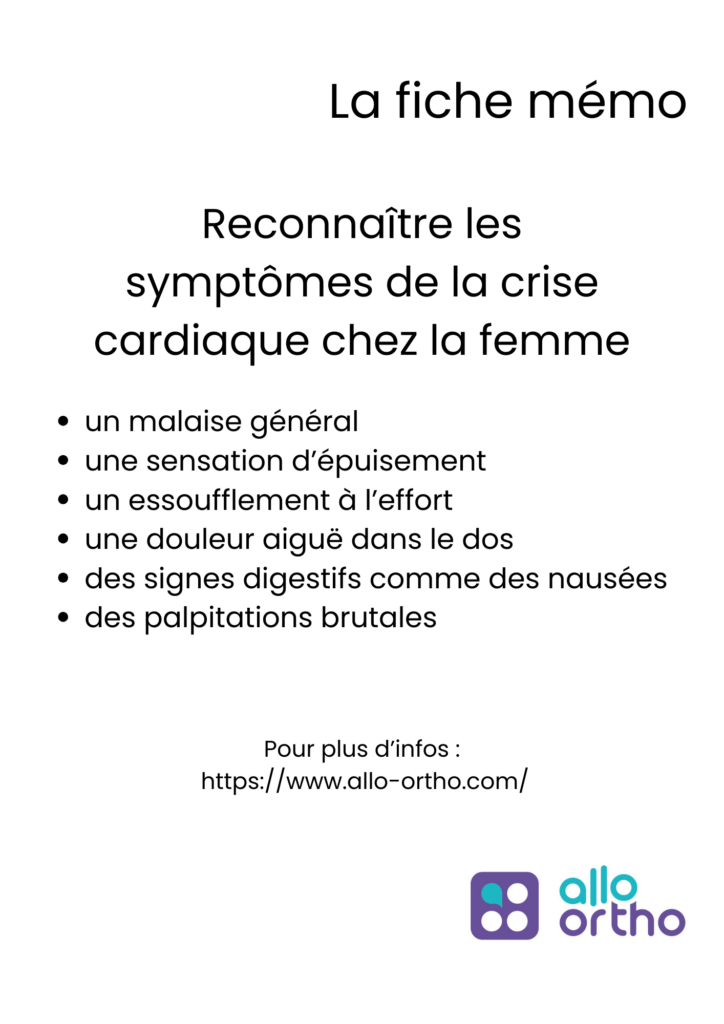La façon dont notre société traite les uns et les autres peut aussi jouer un rôle important dans notre accès aux soins. Cela concerne tout le monde, des enfants aux adultes et en particulier les troubles du langage et de la communication dont s’occupent les orthophonistes.
Ces idées montrent à quel point le sexe – c’est-à-dire nos caractéristiques biologiques – et le genre – c’est-à-dire la façon dont la société voit les garçons, les filles, les hommes et les femmes – peuvent influencer notre santé.
Tout au long de la vie, nous pouvons rencontrer des difficultés de santé qui peuvent affecter le développement ou le maintien de capacités à parler, entendre, lire, apprendre et communiquer. Les nombreux troubles dont s’occupent les orthophonistes sont plus ou moins sévères et touchent les personnes à tous les âges de la vie.
En France, il existe des filières qui permettent de prévenir, d’identifier et de soigner ces troubles. L’orthophoniste fait partie de ces professionnels de santé auxquels on peut faire appel. Lors du premier rendez-vous de bilan orthophonique, est établit un diagnostic à partir d’observations cliniques et d’évaluations formalisées, en lien avec la personne qui consulte et son entourage.
L’orthophoniste s’appuie sur des connaissances scientifiques récentes et solides pour ce diagnostic et sur les échanges avec la personne. Chaque cas est unique ! Les difficultés des uns et des autres sont variables et la façon dont elles impactent la vie quotidienne dépend de plusieurs facteurs.
Certaines caractéristiques personnelles (comme l’âge, les motivations, l’entourage ou la profession) vont ainsi modifier la façon dont chacun vit ces difficultés et s’engage dans la rééducation qui suit ce diagnostic. Cet article s’intéresse aux différences biologiques, sociales et culturelles liées au genre, qui ont également un impact.
Définitions de sexe et genre
L’Organisation Mondiale de la Santé définit le genre comme suit : « le genre fait référer aux caractéristiques socialement construites des femmes et des hommes, telles que les normes, les rôles et relations entre groupe de femmes et d’hommes qui varient d’une société à une autre et peuvent être modifiées », c’est-à-dire le fait d’être assigné à la naissance à un sexe.
Le terme de « sexe » fait plutôt généralement référence aux caractéristiques physiques et biologiques de l’homme ou de la femme, acquises par hérédité, en interaction avec le biologique et l’environnement. En effet l’espèce humaine est considérée comme pouvant évoluer, comme tout autre animal de la Terre, en fonction des nécessités de reproduction et de survie.
Voyons deux exemples dans lesquels le sexe et le genre ont des conséquences sur les troubles du langage : chez l’enfant et chez l’adulte.
Les troubles du langage chez les enfants : une différence marquée
Plus de 4 garçons pour 1 fille présentent un trouble du spectre de l’autisme. La trisomie 21 est présente chez 3 fois plus de garçons que de filles. Ces syndromes génétiques affectent généralement le développement du langage et de la communication.
Les garçons sont en France plus exposés aux troubles du langage : environ 3 garçons pour 1 fille sont concernés par le bégaiement ou des troubles des apprentissages, ou 4 garçons pour 1 fille par des troubles développementaux du langage (TDL), comme ce qui est encore appelé couramment la dysphasie ou la dyslexie/dysorthographie.
Un certain nombre de fausses croyances existent sur cette différence, la science n’a pas encore tout à fait compris les mécanismes qui expliquent ces fréquences d’apparition de ces troubles dans une population donnée (les prévalences). Il semblerait que des facteurs hérités des parents (génétiques), et hormonaux (notamment durant la grossesse) semblent impliqués. N’oublions pas non plus que le développement du langage chez les filles et les garçons est, de façon normale, différente. Les filles parleraient plus tôt, auraient un vocabulaire plus étendu mais cette différence serait compensée autour des deux ans d’âge.
Des facteurs environnementaux, affectant l’éducation des enfants sont également d’importance. La société occidentale a tendance à moins encourager les garçons à verbaliser leurs émotions et leurs difficultés. Par exemple, on attend souvent d’un garçon qu’il soit « fort » et d’une fille qu’elle soit « sage ». La meilleure détection des troubles développementaux chez les garçons pourrait s’expliquer par le fait que ces garçons ont souvent des troubles du comportement associés, qui les font remarquer plus facilement. Les filles, au contraire, « masquent » ces difficultés et compensent parfois mieux à l’école. Sans même en avoir conscience, nous élevons différemment les filles et les garçons et continuons à véhiculer des représentations des rôles de chacun qui sont admis dans notre société.
AVC et rééducation : des parcours différents chez l’adulte
Une fois adultes, les personnes sont également confrontées à des parcours de soin différents selon leur sexe et leur genre. Les particularités des symptômes chez les femmes sont moins connues.
C’est le cas par exemple des maladies cardiovasculaires, qui sont pourtant la première cause de décès en France. Les symptômes des infarctus (crises cardiaques) sont moins visibles et moins connus chez les femmes. L’académie de médecine signale d’ailleurs un risque de mortalité plus important pour les femmes. Celles-ci peuvent ressentir un malaise général, une sensation d’épuisement, un essoufflement à l’effort, une douleur aiguë dans le dos, des signes digestifs comme des nausées, des palpitations brutales. Chez les hommes en revanche, la douleur thoracique et l’irradiation dans le bras gauche sont des signes plus familiers.
Dans d’autres cas, les parcours de soin sont raccourcis. Un sondage réalisé́ par Ipsos pour la Fédération Hospitalière de France (FHF), confirme qu’il existe des biais sexistes dans les prises en charge. En effet les plaintes des femmes sont moins prises au sérieux, ce qui peut retarder les interventions. Une douleur atypique peut être interprétée comme du stress ou autre chose. Cela peut entraîner une prise en charge plus tardive ou de moins bonne qualité.
Dans l’accident vasculaire cérébral (AVC), les femmes restent en moyenne moins longtemps hospitalisées (un tiers de temps en moins) que les hommes pour un AVC. La place occupée par les femmes dans notre société actuelle les pousse à vouloir rentrer plus tôt à domicile pour reprendre les tâches qu’elles assurent quotidiennement. Les conséquences peuvent être importantes : un risque accru de séquelles graves et une charge mentale plus grande.
Les orthophonistes font face à ces différences qui peuvent avoir de larges conséquences sur l’implication des patientes dans leur rééducation et l’évolution des difficultés.
Repenser les interventions pour réduire les écarts
Il est indispensable de tenir compte des particularités biologiques et sociales des femmes et des hommes pour mieux préserver leur santé.
Des organisations comme la Fondation pour la Recherche Médicale œuvrent pour que la recherche clinique prenne davantage en compte les caractéristiques des femmes (cycles hormonaux, étapes de vie), et mette en lumière des facteurs de risques spécifiques. Le dépistage de certaines pathologies (comme les maladies cardiovasculaires ou les cancers) devrait être plus systématique à des âges clés de la vie de la femme.
Et en orthophonie ?
Le développement d’actions de prévention est une priorité déjà bien connue des orthophonistes. Il s’agit de :
- Mieux informer le public sur les pathologies du langage, de la communication et de la déglutition,
- Multiplier les actions de dépistage pour bien identifier les pathologies de façon précoce et éviter les complications et l’aggravation de difficultés simples,
- Faire prendre conscience des biais pouvant retarder les consultations.
Par ailleurs, adapter les parcours de soins à chacun, en prenant en compte les besoins et les particularités de chacun est une priorité. Il faut rapidement repérer les difficultés, et les obstacles (liés au genre, à la famille, au mode de vie…) qui peuvent retarder l’accès aux soins en orthophonie.
La notion de genre est soumise à beaucoup de stéréotypes. Sexe et genre influencent notre santé bien plus qu’on ne le pense, aussi bien à travers notre corps que dans la façon dont nous sommes pris en charge. Cependant il est important que les dépistages, les diagnostics et les traitements puissent être adéquats et pertinents quel que soit le sexe ou le genre de la personne. Les troubles du langage, de la communication et de la déglutition traités en orthophonie doivent également prendre en compte ces biais, les particularités de chacun, afin de proposer les meilleurs soins possibles. Prendre conscience de ces différences, c’est avancer vers un système de soins plus juste et plus efficace, où chaque individu peut être entendu et aidé selon ses besoins. Les orthophonistes et les organisations représentatives en orthophonie œuvrent quotidiennement à une meilleure reconnaissance des besoins individuels.
Pour en savoir plus :
- Enquête inédite Ipsos x FHF « Santé des femmes » : Quand les biais sexistes compromettent la santé des femmes | Fédération Hospitalière de France
- https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/rapport_analyse_prospective_2020.pdf